Et si les villes étaient la reproduction de notre corps humain ?

Le ventre de Paris, le poumon vert de New York, les artères urbaines… autant d’expressions caractéristiques du fonctionnement urbain, qui font pourtant appel à des composantes du système vital humain.
Le Corbusier, qui imposait à ses projets des dimensions issues des mesures du corps humain, intègre dans sa vision de l’architecture l’idéal humain, déjà évoqué par Vitruve, et l’idéal de ses dimensions comme une porte vers le secret d’une conception divine. Mais au-delà même de l’architecture, les éléments qui font la ville (parcs, centre-ville, universités…) semblent eux-mêmes être les organes d’un système plus complexe et complet que le simple domaine de l’architecture : le centre de la ville, son cœur, pourrait par exemple être assimilable à notre muscle palpitant…
Mais n’est-ce qu’une impression ? Un effet de style pour donner du sens aux éléments urbains ? Et si l’homme avait finalement sans s’en rendre compte construit la ville comme étant son propre reflet ? Ou même comme étant le reflet de son camarade vivant, genre d’animal de compagnie urbain ? Chaque jour, nous abreuvons la ville de notre présence, de nos activités ou de nos déplacements. Cette ville que l’on nourrit , cette ville qui grandit et se développe, qui noue des relations plus ou moins intimes avec certaines de ses semblables, ne serait-elle pas l’organisme avec lequel les citadins doivent se conjuguer pour instaurer une symbiose pérenne ? D’ailleurs, ne peut-on pas aujourd’hui parler de Tamagotchi urbain ?
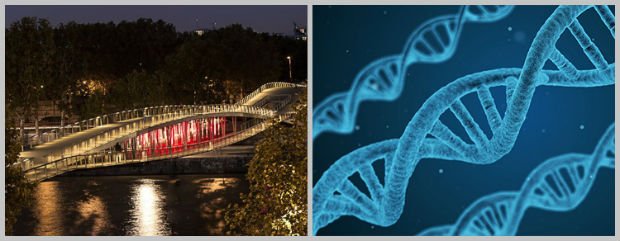
Quand l’architecture et la biologie ne font plus qu’un
Construire la ville pour une perfection éternelle
La ville, par définition, est le propre de l’Homme. Si les espèces animales ont su développer des systèmes complexes de sociétés organisées, comme les communautés de fourmis ou d’abeilles par exemple, l’existence même des cités telles que nous les vivons est caractéristique de l’organisation entre les Hommes. Pourtant, ces cités ont connu une évolution indéniable, dont le sens et l’origine conceptuelle se sont largement transformés au fil du temps.
Initialement, c’est en effet le désir de conférer à la culture humaine une forme d’éternité qui a justifié la construction de villes. Le sillon, l’enceinte dessinée pour Rome par exemple par le mythologique Romulus est bel et bien un acte de sanctuarisation, genre d’autel religieux et cultuel, qui sera le symbole d’une élévation, par la construction de la ville, vers un ciel alors tant mystérieux que chargé de symboles.
Cette construction symbolique des villes, de manière verticale est assimilée par certains comme une volonté de s’approcher des astres, à l’image d’une Tour de Babel dont l’objectif est non-seulement de rassembler des communautés, mais également d’apprendre les uns des autres dans un espace-temps en quatre dimensions. Comme un bras commun, levé par les citadins pour tendre vers un destin partagé.
Si cette construction commune s’est révélée au fil des temps comme étant le reflet culturel de la société qui l’a érigée, elle peut également refléter les plus grandes peurs, mais aussi les plus profonds désirs de l’Homme. En particulier, la question de la mort, et de la vie éternelle, qui animent tant les réflexions philosophiques et religieuses des Hommes en devient transposée à l’échelle de la ville : on souhaite rendre les villes divines et immortelles. Celles-ci se sont construites autour de leurs églises et de leurs cimetières respectifs, dont les flèches et les stèles pointent toujours plus haut. Plus récemment, par la tentative de la part de Le Corbusier de trouver des valeurs humaines idéales, transposables aux bâtiments et aux espaces de vie dans les villes, l’humanisation des cités devient davantage constatée, bien qu’elle soit encore peu abordée. Il semblerait par conséquent qu’à travers la ville, les Hommes veuillent eux-mêmes s’élever, et la construction de la cité serait donc symboliquement comparable à l’Homme qui se dresse.

La Tour de babel – Jan Van Scorel (1550)
De la ville éternelle à la ville résiliente
Mais depuis quelques décennies, la personnification des villes prend de l’ampleur. Le symbole religieux et philosophique est en outre complété par une approche concrète plus proche des sciences de la vie. Aujourd’hui, les enjeux sociétaux ainsi que les enjeux climatiques poussent les bâtisseurs urbains à apporter une notion particulière à leurs projets d’aménagement et/ou d’architecture. De la recherche de la ville éternelle, le défi actuel semble être devenu de trouver ce que les urbanistes appellent la « ville résiliente ». La résilience est la capacité à encaisser une perturbation qui pourrait compromettre le développement urbain. Mais la résilience signifie également être capable de rebondir, de « se réparer » et de poursuivre son évolution sans que la perturbation ne l’ait affectée. Dans le domaine de la biologie, plusieurs espèces ont cette capacité de résilience, comme le lézard dont la queue peut repousser si elle a été coupée, ou comme l’étoile de mer dont les branches ont cette même faculté de résistance.
Le souhait de conférer à nos villes une telle capacité est par ailleurs renforcé par un rapport de plus un plus intime avec les éléments issus de la nature. Non seulement l’utilisation de matériaux naturels et durables est privilégiée, mais certaines réflexions architecturales intègrent dans les projets une dimension bien plus poussée et bien plus proche de la force de la Nature. Parmi les architectes qui intègrent au maximum cette notion, le belge Vincent Callebaut est certainement l’exemple le plus médiatisé. Sa réflexion est alimentée par les capacités biologique de la nature à s’adapter à son environnement, notamment en ce qui concerne les plantes, mais aussi le domaine animal.
En termes de résilience et d’adaptation à l’environnement, plusieurs projets assument pleinement l’utilisation des compétences de la biologie. Par exemple le projet Lilypad, qui signifie « nénuphar » en français, est une conception de l’architecte belge dont l’ambition est de retranscrire à des villes flottantes le fonctionnement des fameuses plantes aquatiques. À l’image de ces dernières, les villes du projet Lilypad seraient donc flottantes et permettraient de s’adapter au niveau des océans, à une époque où son élévation met en péril des dizaines de villes terrestres « fixes », et malheureusement des populations entières qui vivent en milieu littoral ou insulaire.

Le projet Lilypad de Vincent Callebaut, présenté en 2008
L’architecture « biomimétique », c’est-à-dire qui s’inspire de la nature, n’a pas seulement l’ambition d’en recréer l’aspect physique. L’objectif est surtout aussi de pouvoir se développer de façon autonome, par exemple en se nourrissant des apports de la nature (eau, vent…) pour créer sa propre énergie qui lui permettrait de vivre et de grandir, bref de se développer. Si l’architecture commence donc à prendre cette tournure davantage orientée vers les forces de la nature pour s’en inspirer, le monde urbain semble lui aussi pouvoir être assimilé à des fonctions biologiques animales voire humaines.
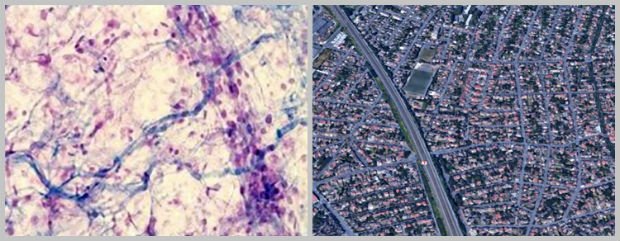
Les voies de circulations peuvent être assimilées au réseau sanguin, ou comme ici, au tissu conjonctif
L’urbain comme reflet de notre rapport au corps humain
Ce que l’on appelle ici les « organes de la ville » évoqués précédemment correspond à tous les éléments urbains qui définissent la ville, qu’il s’agisse d’infrastructures, de bâtiments ou encore d’ensembles urbains. On remarque que chacun de ces éléments a une fonction bien particulière en ville, que l’on pourra comparer aux fonctions biologiques des organes d’un être vivant. Parmi les multiples exemples, les Halles de Paris sont certainement l’un des plus populaires. Reconnues par Émile Zola comme étant le Ventre de Paris, elles sont le lieu par où transite une abondance de denrées qui nourrissent l’ensemble de la ville…
À New York, Central Park est surnommé le « poumon vert » de la ville. La présence d’un immense espace vert au cœur de la métropole apporte non seulement une indéniable fraîcheur revigorante mais permet par ailleurs de traiter une partie du dioxyde de carbone rejeté en le transformant en oxygène. Les exemples sont multiples et les relations entre les éléments urbains et l’anatomie du vivant peuvent être établis de nombreuses manières.

Central Park est considéré à l’échelle de New-York comme son « poumon vert »
Les axes de circulation que l’on peut parfois appeler « artères » pourraient être comparés au réseau sanguin ou au réseau neuronal d’une espèce animale : par leurs fonctions de transports, ils alimentent les organes de la ville par le biais de vaisseaux plus ou moins étroits, et assurent une cohésion de l’ensemble de l’organisme.
Par les qualificatifs et les petits noms que nous donnons aux composants urbains, ne donnons-nous pas la preuve que nous souhaitons nous rapprocher intimement de nos villes ? En voulant comparer la ville à un organisme, ne souhaitons-nous pas lui donner notre sens ? Ne contribuons-nous pas à donner une raison d’être aux espaces urbains et à la cité en général ? Il semblerait également que ces éléments soient l’indicateur d’une volonté de construire la ville à notre image dans le but d’évoluer conjointement.
C’est donc par la main de l’homme que la cité s’est construite. Mais il semblerait que nous essayons petit à petit de la laisser se développer de façon autonome, en lui greffant uniquement les organes nécessaires à sa croissance. Ce qui s’exprimerait notamment avec l’apparition de l’architecture biomimétique. La ville grandit, la ville se fait belle et révèle une identité qui lui est propre, une culture qui reflète celle des hommes avec lesquels elle vit. Elle s’affirme. La ville peut même nouer des relations avec d’autres ! La ville devient indissociable de ses citadins. Le rapport que ceux-ci cultivent ne serait-il pas assimilable celui que nous entretenons avec notre propre corps ?
Pourtant, cette construction commune entre la cité et ses citadins est-elle vraiment durable ? Si un futur partagé semble dessiné, comment les évolutions technologiques, sociales et climatiques pourront-elles contribuer à favoriser le destin intime de la ville et de ses hommes ?